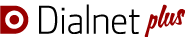Biogeohydrodynamic in the forested humid tropical environment: the case study of the Nsimi small experimental watershed (south Cameroon)
- Autores: Jean-Jacques Braun, Bernard Dupré, Jérôme Viers, Jules Rémy Ndam Ngoupayou, Jean-Pierre Bedimo Bedimo, Luc Sigha-Nkamdjou, Rémi Freydier, Henri Robain, Brunot Nyeck
- Localización: Bulletin de la Société Géologique de France, ISSN 0037-9409, Vol. 173, Nº. 4, 2002, págs. 347-357
- Idioma: inglés
- Títulos paralelos:
- Le petit bassin versant experimental de Nsimi (sud Cameroun): exemple d'observatoire naturel du fonctionnement biogéohydrodynamique de l'écosysteme forestier tropical humide sur roche ignée silicatée
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
-
Resumen
- English
This paper summarizes a six-year study of the Nsimi Small Experimental Watershed (SEW), considered as a model for the South Cameroon humid tropical ecosystem. When this small watershed was set up, no similar survey of input/output hydrobiogeochemical fluxes in granitoid rocks in stable cratonic environment was available, to our knowledge, on any site close to the Equator. Moreover, this is the first attempt, world-wide, to combine different approaches in hydrology, (bio)geochemistry, mineralogy, crystallography, microbiology, geophysics and pedology. Research is based on (1) regular hydrobiogeochemical surveys in various water reservoirs of the SEW ecosystem (atmospheric deposits, groundwater and stream), (2) surveys related either to the organisation and composition of different reservoirs in the superficial layers (basement rocks, saprolite, soils) or to various hydrological, biological and geochemical processes. These surveys aim at (1) finding the main parameters involved in the chemical and physical erosion processes of the humid tropical ecosystem, (2) understanding the source of a particular chemical composition in groundwater and rivers, (3) documenting accurately the different exportation processes of chemical elements in water and soil (4) investigating the possible relation between the biodegradation of soil organic matter and the leaching of metals (especially iron) and (5) comparing the long and short term weathering rates using mass balance calculations. Another important objective of this study is to provide a new scientific and engineering database for the future development of South Cameroon, which is still nowadays a relatively preserved ecosystem.
One of the major results is the essential role played by the biological cycle (vegetation and soil organic matter) in the fractionation, exportation or storage of the chemical elements in humid tropical environments. Moreover we are able to propose a model of the current erosion for this SEW from the database obtained on (1) the mineralogy of the basement rocks and the soil layers, (2) the geochemistry of the soluble and colloidal phases of waters and (3) the hydrology within the different reservoirs of the hydrosystem. This model has been confirmed and extended on a regional scale (Nyong river basin). It emphasized the behaviour of the main elements of the tropical soil layers (Fe, Al, Si), the nutrients (C, Ca, Mg, K, Sr) and specific tracers of the weathering processes either with strong mobility (Cl, Na) or on the contrary with an extremely low mobility (Zr, Th, REEs).
On the SEW scale, a strong geochemical contrast occurs between the different groundwater zones flooding (1) the hill slope lateritic profiles, (2) the weathering front (interface between the saprolite and the basement rocks), and (3) the swampy zone in which the Mengong brook flows. High DOC contents (15 mg/L) but also high Fe, Th, Al, Zr contents characterize the swampy zone waters. Na and Si have mainly a deep origin (exfiltration), Al, Th, Zr and REEs are strongly linked with colloidal organic matter located in the upper horizons of the swamp. Fe has a much more complex behaviour due to its change of redox state which can be independent of organic matter complexation. Concerning the major base cations, their origin can be constrained by the biological cycle (storage or leaching). K is typically influenced by the biological cycle. During the floods, Cl has the same behaviour as K: it is one of the most striking points of this study. However, the Cl annual budget is balanced.
These characteristics can be understood as the consequence of the weathering of the minerals present in the saprolite (kaolinite, goethite, zircon, Th-oxide). This chemical weathering allows the leaching of base cations and also Al and Fe. It has been demonstrated that the microbial populations of the swampy zone can play an important role in the mobilization of transition metals (e.g. Fe). This study point out the role of humic acids in the transport and the weathering budget of elements usually considered as immobile in the superficial cycle (e.g. Al, Th, Zr, Fe).
It must be mentioned that worldwide the SEW and even the Nyong network waters are among the least concentrated river waters. It means that even if the organic matter plays an important role in the mobilization and transport of some elements in the swampy zone, its action is limited in term of major cation fluxes on the SEW scale. The reason invoked is that the cation fluxes are directly linked to the pedological history and the geomorphology of the watershed. The presence of thick soil layers composed of saprolite and latosol on the hillsides and of hydromorphic soils in the swampy zone with constant mineralogy lead to isolating the bedrock. The long residence time of water close to the weathering front plays a major role in preserving the parent rock from the hydro-chemical outputs. Moreover, the topsoil layers are stabilized by the vegetation cover, which limits mechanical erosion. This should be taken into account for the carbon mass balance calculation because of the wide areas on stable shields concerned by the humid tropical ecosystems. Moreover, comparison between long and short-term weathering allows us to suggest that paleo-climatic conditions did not change since the Miocene (6-20 Ma) in this part of the world.
- français
Cet article propose une synthèse des travaux réalisés au cours des six années d'étude du petit bassin versant expérimental (PBVE) de Nsimi considéré comme observatoire naturel de l'écosystème tropical humide du Sud-Cameroun. Lorsque nous avons installé ce PBVE, il n'existait, à notre connaissance, aucun site proche de l'équateur étudié en termes de flux hydrobiogéochimiques entrées/sorties sur roches alumino-silicatées en zone cratonique stable. De plus, ce site est le premier au monde où a été entreprise une approche combinée en hydrologie, (bio)géochimie, minéralogie, cristallographie, microbiologie, géophysique et pédologie. Les actions de recherche sont basées sur (1) des suivis hydrobiogéochimiques réguliers dans les différents réservoirs aquifères à l'échelle de l'hydrosystème PBVE (dépôts atmosphériques, nappes phréatiques et ruisseau) et (2) des études plus ponctuelles concernant, soit l'organisation et la constitution des différents réservoirs des formations superficielles (roche-mère, saprolite, sols) soit divers processus intervenant dans les cycles hydrologique, biologique et géochimique. Ces actions visaient à (1) rechercher les paramètres prépondérants qui contrôlent l'érosion chimique et mécanique de l'écosystème tropical humide, (2) comprendre l'acquisition d'une composition chimique donnée par les eaux de nappes et de rivières, (3) connaître précisément les différentes formes de transfert des éléments chimiques dans les eaux et les sols, (4) mettre en évidence la relation possible entre la biodégradation des matières organiques du sol (MOS) et la solubilisation d'éléments minéraux (en particulier le fer) et (5) comparer les bilans de l'érosion actuelle et passée. Un autre aspect important de cette étude est d'apporter une nouvelle base de données aux scientifiques et ingénieurs pour le développement futur du Sud Cameroun qui est encore, de nos jours, une région relativement préservée des actions anthropiques.
Le résultat majeur est la mise en évidence du rôle moteur essentiel joué par le cycle biologique (végétation, matière organique des sols (MOS)) dans les processus de transfert et/ou de stockage des éléments dans les régions tropicales humides. Il a été en outre possible, grâce aux données acquises (1) en minéralogie sur le substratum rocheux et les formations superficielles, (2) en géochimie sur les phases soluble et colloïdale des eaux et (3) en hydrologie sur les différents réservoirs de l'hydrosystème, de proposer un modèle de l'érosion actuelle pour ce PBVE. Ce modèle a été confirmé et étendu à l'échelle régionale du bassin fluvial du Nyong. Il rend plus particulièrement compte du comportement des principaux éléments constitutifs des formations superficielles tropicales (Fe, Si, Al), des nutriments (carbone, cations de base majeurs ou en trace Ca, Mg, K, Sr) et de traceurs spécifiques des processus d'altération/érosion, soit à forte mobilité hydrolitique (Cl et Na) soit, au contraire, à mobilité extrêmement limitée (Zr, Th, terres rares).
A l'échelle du PBVE, il existe un fort contraste géochimique entre les différentes zones de la nappe phréatique baignant (1) les profils latéritiques des collines, (2) le front d'altération (interface entre saprolite et roche-mère) et (3) le bas-fond marécageux dans lequel s'écoule le ruisseau Mengong évacuant les eaux du PBVE. Des expériences d'ultrafiltration (jusqu'à 1 KD) ont permis d'appréhender le comportement des éléments dans les différentes fractions particulaire, colloïdale et dissoute des différents réservoirs.
Dans les eaux de nappes de versant baignant les profils latéritiques les concentrations de silice et d'aluminium sont en équilibre avec le quartz et la kaolinite alors que le fer est en équilibre avec un hydroxyde de fer amorphe. Le thorium, le zirconium et les terres rares sont principalement contrôlés par les phases solides colloïdales minérales.
Au front d'altération, les concentrations en silice sont quatre fois plus élevées que dans les parties supérieures des nappes de versant et ne correspondent plus à des concentrations en équilibre avec le quartz et la kaolinite. Toutefois, les concentrations en aluminium sont très faibles et peuvent être considérées comme étant en équilibre avec la kaolinite. Les fortes concentrations en silice et en cations de base (Ca, Na, K) sont expliquées par la dissolution des plagioclases et des feldspaths primaires.
Les eaux de nappes de bas-fond sont caractérisées par des quantités importantes de carbone organique dissous (COD ; 15 mg/L) mais aussi de fortes concentrations en Fe, Al, Th et Zr. L'origine des éléments a pu être déterminée en échantillonnant en continu une crue. Il se dégage de l'analyse de celle-ci que Na et Si ont essentiellement une origine profonde (exfiltration de nappe), que Al, Th, Zr et les terres rares sont fortement liés à la matière organique colloïdale localisée dans les horizons supérieurs du bas-fond. Le fer a un comportement plus complexe lié au changement possible de son degré d'oxydation qui peut être indépendant de la complexation par la matière organique. Pour les cations majeurs, l'origine est un peu plus complexe à déterminer et l'augmentation des concentrations peut être due à des processus de déstockage par le couvert végétal. Le potassium est l'élément type de la mobilisation par le cycle biologique. Lors de la crue, le Cl a le même comportement: c'est l'un des résultats les plus novateur s de cette étude. Toutefois à l'échelle du cycle hydrologique annuel, le bilan du Cl est bouclé.
Ces caractéristiques peuvent être interprétées par l'altération dans les bas fond des minéraux présents dans les saprolite (kaolinite, goethite, zircon, oxyde de thorium). Cette altération a pour conséquence de libérer, outre Al et Fe, des cations. Il a été montré que les populations microbiennes des bas-fonds marécageux peuvent jouer un rôle non négligeable surtout en ce qui concerne la mobilisation des métaux de transition (exemple de Fe). L'un des résultats fondamentaux de cette étude est la confirmation du rôle joué par les acides humiques dans le transport des éléments réputés à mobilité hydrolitique extrêmement faible (par exemple Al, Th, Zr, Fe) et l'importance de ces mêmes acides dans les bilans d'altération.
Si l'on compare les concentrations des cations majeurs (Ca, Mg, Na, K) à celles d'autres rivières de la planète, force est de constater que les eaux du PBVE de Nsimi et du bassin fluvial du Nyong sont parmi les moins chargées du monde. Ceci sousentend que, même si la matière organique joue un rôle prépondérant dans la mobilisation et le transfert de certains éléments dans les zones marécageuses, cela n'a pas un effet majeur en termes de flux de cations produits à l'échelle du bassin. La raison invoquée pour expliquer cela est directement liée à l'histoire pédologique et à la géomorphologie du PBVE. La présence d'une formation superficielle épaisse constituée de saprolite, de latosols sur les collines et de sols hydromorphes dans les bas-fonds dont la composition minéralogique est monotone isole la roche-mère des agents d'érosion chimique (matière organique, eaux météoriques), limite les circulations des fluides et par conséquent protège la roche mère de l'érosion chimique et limite le flux de cations majeurs. En outre, ces couvertures de sols sont par ailleurs stabilisées par le couvert végétal qui limite l'érosion. Ce rôle protecteur des sols vis-à-vis de l'érosion chimique, déjà mis en évidence à plus petite échelle par Stallard [1983] est ici clairement montré tant à l'échelle du PBVE de Nsimi que du bassin fluvial du Nyong. Ceci est à prendre en compte dans les calculs de bilan du cycle du carbone pour les surfaces considérables que les écosystèmes forestiers tropicaux sur craton stable représentent à l'échelle du globe. Par ailleurs, les comparaisons entre érosion chimique court et long terme permettent de supposer que les conditions paléo-climatiques n'ont que peu changée depuis au moins le Miocène (20 Ma) dans cette partie du monde.
- English
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados